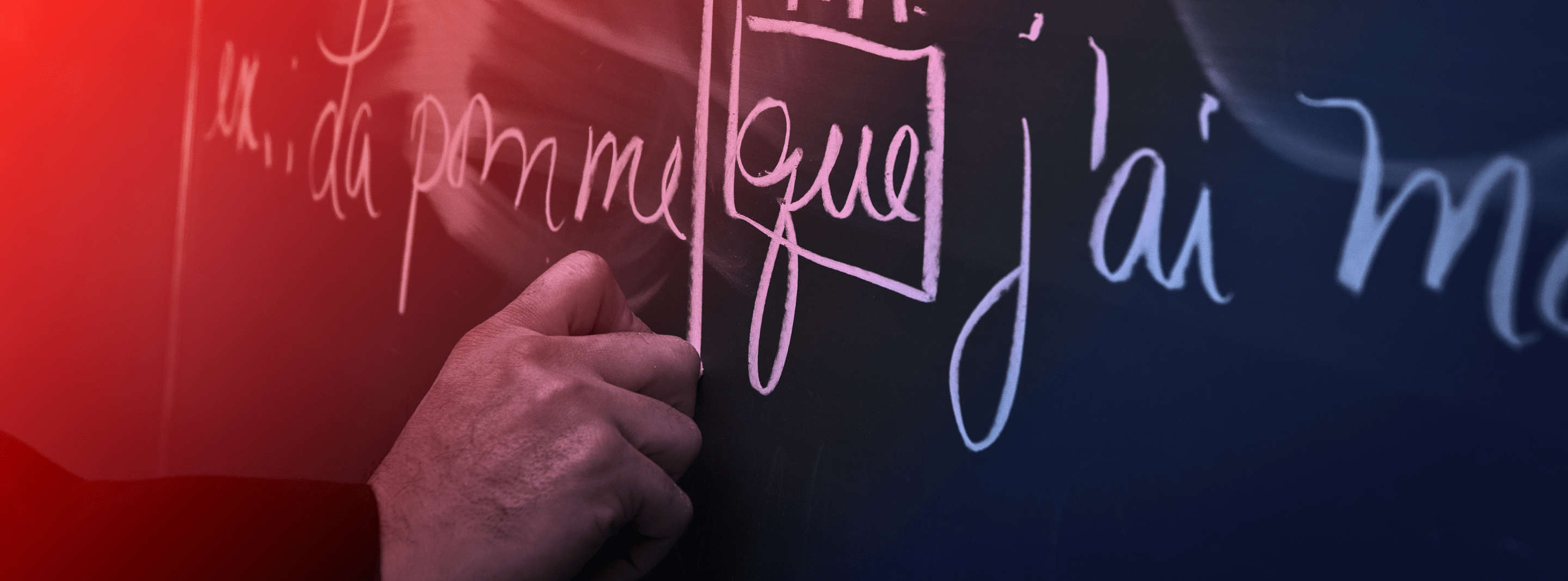
Un casse-tête de francisation
Élément clé du maintien du français au Québec, surtout si les seuils d’immigration font grimper la population canadienne à 100 millions d’habitants, la francisation des immigrants relève déjà, à l’heure actuelle, du parcours du combattant.

L’ambition d’Ottawa de faire exploser la population canadienne par une hausse radicale des seuils d’immigration risque d’affaiblir grandement le Québec et de menacer la survie du français.
L’un des moyens de contrer cet effet réside dans la francisation massive des immigrants.
Or, cela demande déjà énormément de bonne volonté pour ces nouveaux arrivants qui choisissent le Québec, comme le raconte Roberta Paula Vieira Vianna.

Un long parcours
L’infirmière brésilienne, qui a passé la dernière année à temps plein en classe de francisation, commence à peine à se sentir à l’aise en français.
Suffisamment, en tout cas, pour remplir les formulaires de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui lui permettront éventuellement de pratiquer dans nos hôpitaux.
« Dans mon métier, c’est important de comprendre et d’être comprise », note celle qui est arrivée au Québec en octobre 2021 dans un français tout à fait acceptable.
La femme de 39 ans s’est installée dans la ville de Québec avec son conjoint, lorsque celui-ci a obtenu un emploi en informatique.
Mais avant même de penser à apprendre le français, il fallait inscrire la petite Clara à la garderie et le petit Gabriel à l’école, ce qui s’est révélé, en soi, toute une entreprise pour la petite famille.
Trois mois pour une réponse
Mme Vieira Vianna s’est finalement inscrite aux cours de francisation à travers le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), trois mois après son arrivée, une fois la famille installée.

Sur le conseil d’un ami, elle s’est aussi inscrite directement au Centre d’éducation des adultes Le Phénix, à Québec.
Elle s’en félicite aujourd’hui, puisque l’appel du MIFI est finalement venu… trois mois après qu’elle eut commencé ses cours au Phénix.
« On apprend le vocabulaire pour faire l’épicerie ou les choses culturelles comme la cabane à sucre », raconte-t-elle.
Après une année en classe, elle remarque que son français est désormais meilleur que celui de son conjoint, qui peut seulement suivre deux cours de soir par semaine, en raison de son emploi.
Pas tous égaux
Certains étudiants partent toutefois de beaucoup plus loin.
« Il y a une grande quantité d’élèves qui viennent ici et qui sont analphabètes » dit Joël Garneau, directeur du Centre d’éducation des adultes Le Phénix, à Québec.
Ce dernier plaide d’ailleurs pour que le gouvernement du Québec ajoute des ressources afin d’aider les nouveaux arrivants à faire face à la bureaucratie québécoise.
Anglophones et allophones (en millions)
Francophones (en millions)
Au Centre multiethnique de Québec, premier point de chute de bien des arrivants dans la Capitale-Nationale, Natacha Battisti observe aussi que les conditions socioéconomiques jouent un grand rôle dans le succès de la francisation.
La directrice générale donne l’exemple d’une famille qui doit envoyer trois enfants dans une garderie privée, au coût de quelque 40 $ par jour chacun.
« Pour cette raison, l’homme va souvent chercher ses cours de francisation en premier et la dame attend pour y aller par la suite », illustre-t-elle.
Milieu de travail
Mme Battisti estime qu’une partie de la solution se trouve dans la francisation en entreprise, comme cela peut parfois se faire.
Au Centre Phénix, où on offre de telles formations, on souligne toutefois les limites du modèle en milieu de travail.

« Le besoin en entreprise, c’est souvent pour être fonctionnel sur place, alors qu’à l’école on va parler du logement, des impôts, etc. », explique Joël Garneau.
L’arrivée prochaine du guichet unique Francisation Québec devrait, en théorie, simplifier le parcours pour les nouveaux arrivants.
Toutefois, cela facilitera la vie des immigrants seulement si les ressources sont au rendez-vous.
« On l’a vu pour d’autres sites avec un accès unique, comme les CPE. Est-ce qu’on va donner un accès rapide ou se ramasser avec des listes d’attente incroyables ? », se questionne à voix haute Mme Battisti.

4 pistes pour une francisation réussie
Pas besoin de réinventer la roue pour franciser les nouveaux arrivants avec succès. Des initiatives déjà en place permettent de bien intégrer ces néo-Québécois afin de leur donner le goût d’apprendre la langue et de s’installer ici de façon permanente.
Miser sur les étudiants
Dans le Bas-Saint-Laurent, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) attire de nombreux étudiants internationaux. Une majorité d’entre eux s’installe au Québec par la suite, affirme l’Université.
Bien entendu, l’UQAR recrute beaucoup dans les pays francophones, mais aussi des étudiants de l’Amérique latine déjà à l’aise en français. « Ça leur permet de vivre l’expérience [du Québec] et après plusieurs veulent rester sur le territoire québécois. C’est un bon moyen d’intégration », affirme Carlos Castaño, directeur du bureau du recrutement étudiant.
Pour les aider, l’Université mise sur l’entraide avec le comité des étudiants internationaux, mais aussi sur le parrainage avec des étudiants québécois. « Il y a des partages de nourriture, par exemple, d’expressions. Ça permet de se faire l’oreille », illustre M. Castaño.
Même le personnel de l’UQAR est mis à contribution pour tenter de loger ces étudiants internationaux, devant la pénurie de logements qui sévit à Rimouski comme dans bien des régions.
Régionaliser
À Saint-Georges, en Beauce, un millier de travailleurs étrangers sont présentement en classe de francisation, un nombre « astronomique » pour la région, souligne le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) local, Martin Beaulieu.

C’est que les employeurs ont besoin de renforts pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans les nombreuses usines du coin. « Ce n’est pas rare qu’une entreprise nous dise : dans deux semaines, j’attends 10-15 nouveaux employés » de l’étranger, illustre M. Beaulieu.
Quelque 70 familles ukrainiennes se sont aussi installées dans la région depuis le début de l’invasion russe.
La situation géographique de la Beauce aide à intégrer ces nouveaux arrivants en français, même s’il n’est pas toujours évident de suivre des cours après une longue journée de travail.
Toutefois, un tel afflux nécessite des efforts importants pour permettre une arrivée en douceur. Le CJE accompagne donc ces nouveaux arrivants lors de leur première épicerie ou dans la recherche d’un logement et organise même… des ateliers pour apprendre comment s’habiller l’hiver.
« Récemment, on a amené un groupe en raquettes. En avril, on s’en va à la cabane à sucre », raconte M. Beaulieu.
Franciser en amont
On ne s’attendrait pas à trouver une importante communauté de Philippins à huit heures au nord de Montréal. Pourtant, ils seront près de 120 d’ici l’été prochain dans les usines de Chantiers Chibougamau, soit 25 % des employés.

L’entreprise recrute dans ce pays du Sud-Est en raison de la pénurie de main-d’œuvre et parce que les travailleurs y sont généralement bien formés pour le travail manufacturier automatisé.
Mais comme les délais en immigration sont longs, Chantiers Chibougamau les paient pour qu’ils fréquentent, à temps plein, des classes de francisation à Manille, en attendant leur arrivée en sol québécois.
Et ça fonctionne. La maîtrise du français de ces nouvelles cohortes est « incomparable » avec celle des précédentes, francisées uniquement au Québec, affirme le directeur exécutif, Frédéric Verreault.
Les enfants de la loi 101

Parfois, le processus de francisation est accéléré par le passage des enfants dans le réseau scolaire francophone, en vertu de la loi 101.
Lorsqu’ils ont déménagé des Émirats arabes unis vers le Québec, à titre d’immigrants économiques, les parents de la députée solidaire Ruba Ghazal parlaient uniquement l’arabe et l’anglais.
Si bien que la petite Ruba et ses sœurs, francisées en classe d’accueil puis à l’école, devaient aider leurs parents à déchiffrer les nombreux documents gouvernementaux à remplir durant leurs premières années au Québec. « On avait 10 ans, 11 ans, et on essayait de comprendre », relate Mme Ghazal en riant.
Par la suite, c’est encore l’école qui a été un vecteur de francisation, à travers l’aide aux devoirs et les événements sociaux. La mère de Ruba Ghazal puisait dans ses lointaines notions de base en français, apprises à titre de réfugiée palestinienne au Liban, pour suivre les devoirs de ses filles. « Disons qu’elle apprenait avec moi », résume Mme Ghazal.